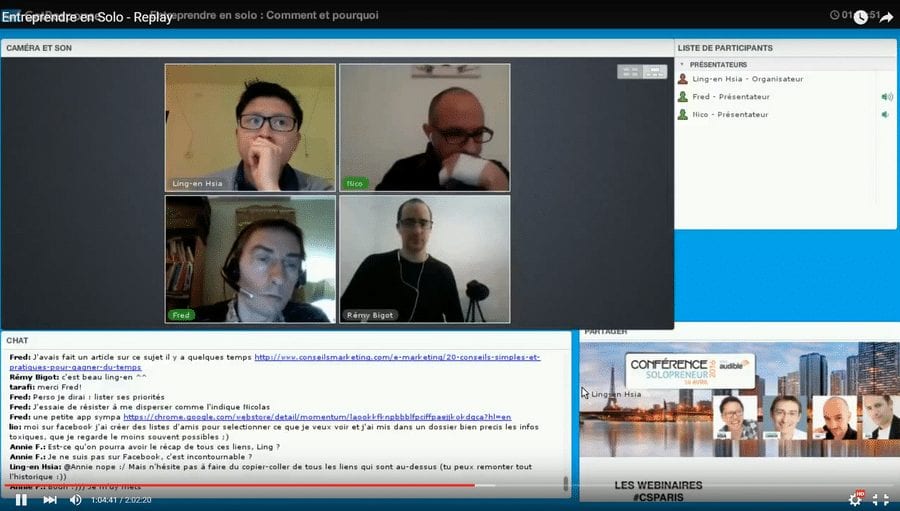5 000 euros : un simple seuil, mais un véritable casse-tête pour bien des entreprises lorsqu’il s’agit de saisir le juge. Depuis le 1er janvier 2020, la saisine du juge pour un litige inférieur à 5 000 euros impose, sauf exceptions, d’avoir tenté une résolution amiable préalable. Le non-respect de cette exigence entraîne l’irrecevabilité de la demande en justice, à moins de justifier d’un motif légitime.La multiplication des modes alternatifs de règlement des différends modifie ainsi les stratégies contentieuses des entreprises. Cette évolution soulève des interrogations sur la portée réelle de l’obligation et sur l’efficacité des solutions amiables dans le traitement des conflits commerciaux.
Comprendre l’article 750-1 du Code de procédure civile : cadre et objectifs
L’article 750-1 du code de procédure civile occupe une place de choix dans la refonte de la procédure civile à la française. Son parcours est jalonné de textes successifs, de retours en arrière et d’arbitrages. Abrogé, rétabli, renforcé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 puis le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 après contrôle du Conseil d’État, son histoire témoigne d’une véritable tension autour de la modernisation du règlement judiciaire des différends.
Cette règle impose en pratique d’engager une tentative de résolution amiable préalable, conciliation, médiation ou procédure participative, avant toute saisie du tribunal judiciaire pour un litige inférieur ou égal à 5 000 euros, ou en cas de trouble anormal de voisinage. Signalée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, cette tendance assoit l’accord amiable comme étape incontournable, avec deux objectifs : désengorger les juridictions et replacer le juge au cœur des litiges qui résistent vraiment au dialogue.
Les exceptions font l’objet d’un inventaire strict à l’article 750-1 : homologation d’accord, présence d’un motif légitime, nécessité d’un recours préalable, échec d’une procédure simplifiée de recouvrement, ou encore l’existence d’une obligation amiable déjà prévue par la loi. Si cette démarche fait défaut, le risque est concret : la demande risque l’irrecevabilité ou la nullité de forme, et le juge veille au grain.
En parallèle, l’article 54 du CPC est clair : toute requête doit relater précisément les démarches amiables qui ont précédé. La procédure civile s’inscrit ainsi dans un véritable virage : négociation, transparence, et responsabilité sont au centre du jeu.
Quels litiges d’entreprise sont concernés par l’obligation de tentative amiable ?
L’esprit de l’article 750-1 du code de procédure civile cible une catégorie précise de litiges civils : ceux traités devant le tribunal judiciaire dont l’une des demandes ne dépasse pas 5 000 euros, ou qui relèvent du trouble anormal de voisinage. Les entreprises, très exposées aux problématiques de recouvrement ou de prestations, sont donc particulièrement concernées par cette contrainte.
Dans le quotidien, cette obligation vise des conflits familiers : arriérés de paiement, prestations non exécutées, désaccords contractuels de petite valeur. Lorsqu’une société souhaite poursuivre un client pour une créance de 4 800 euros, elle doit, hors dérogation, passer par une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative. Les exceptions, elles, restent circonscrites à cinq cas : homologation d’accord, recours préalable obligé, motif légitime, tentative amiable imposée ailleurs par la loi, ou insuccès avéré d’une procédure simplifiée de recouvrement.
Pour clarifier, voici les situations le plus souvent concernées par la tentative amiable préalable :
- Recouvrement de créances ≤ 5 000 euros : la société ou son conseil doit enclencher la démarche de dialogue avant d’espérer saisir le juge.
- Litiges commerciaux annexes : retards de livraison, prestations jugées incomplètes, ou conflits de voisinage entre professionnels.
Certains domaines restent à l’écart, en particulier ceux couverts par des dispositifs propres (crédit à la consommation, immobilier). Pour éviter toute sortie de route, attention à bien qualifier le litige : seuls les litiges du tribunal judiciaire sont concernés, pas ceux du tribunal de commerce. Cette distinction, conjuguée à la diversité des procédés amiables, pousse les entreprises à repenser leur approche, à planifier chaque étape et à réunir l’ensemble des preuves nécessaires dès l’ouverture du dossier.
Panorama des modes alternatifs de règlement des différends : avantages et limites
La palette des modes alternatifs de règlement des différends (MARD) ne cesse de s’étendre, tandis que les juridictions encouragent autonomie et pragmatisme. Sur le terrain, trois options dominent : conciliation, médiation et procédure participative, chacune avec ses atouts et ses contraintes.
La conciliation, portée par un conciliateur de justice, est appréciée pour sa gratuité et son accessibilité. Quelques échanges suffisent parfois pour trouver un terrain d’entente en quelques semaines. Si la rencontre aboutit à un accord, une homologation judiciaire peut être sollicitée, rendant la décision exécutoire. Néanmoins, la conciliation n’a rien de magique : la coopération des deux parties reste la condition sine qua non.
La médiation propose une démarche sur-mesure, neutre et confidentielle. Le médiateur guide le dialogue, sans imposer sa solution, pour permettre aux parties de bâtir une issue qui leur convient. Cette formule peut parfois restaurer une relation commerciale abîmée ou débloquer un dossier figé. Elle suppose cependant une implication sincère, du temps, et parfois des frais, ce qui n’en fait pas une solution universelle.
La procédure participative fait appel à des avocats pour structurer et sécuriser le débat. Elle remporte les suffrages sur les litiges complexes, où la précision juridique et la volonté de formaliser les échanges priment. Mais cette option s’avère plus lourde, et plus coûteuse, que les démarches précédentes.
Avant de saisir le tribunal, deux aspects requièrent une attention particulière :
- Justifier précisément la tentative amiable : il faut fournir une attestation, un document émanant du conciliateur, ou tout élément montrant une réelle initiative amiable.
- Le juge examine l’effectivité de la démarche, et peut refuser d’ouvrir le dossier si la preuve est absente ou insuffisante.
Ressources pratiques et institutions à mobiliser pour les entreprises
Les entreprises disposent aujourd’hui d’un large éventail de relais pour répondre à l’obligation d’engager une résolution amiable avant toute action judiciaire. Le ministère de la justice encadre la politique de l’amiable et outille les acteurs en ce sens.
Dans la pratique, le conciliateur de justice reste un allié de premier plan pour les litiges de petite valeur. Il accueille les parties au tribunal ou en mairie, écoute chacune, et tente de rapprocher les points de vue sans formalisme.
Pour des cas plus sensibles, ou lorsqu’une expertise sectorielle est requise, il est possible de solliciter un médiateur agréé. Les dossiers qui réclament un cadre strict ou qui comportent des enjeux juridiques complexes peuvent bénéficier d’une procédure participative, menée par des avocats rompus à l’exercice.
Le Conseil national de la médiation joue un rôle de contrôle de la qualité des pratiques, en promouvant la déontologie et la compétence des intervenants mobilisés.
Pour faciliter la préparation d’un dossier et accélérer la procédure, il est judicieux de rassembler dès l’origine tous les justificatifs nécessaires : attestations, constats, échanges de courriers ou d’emails. La preuve de la démarche amiable doit impérativement accompagner la requête initiale, conformément à l’article 54 du CPC.
Impossible de l’ignorer aujourd’hui : préparer, documenter et privilégier le dialogue ne sont plus des options facultatives pour les entreprises qui souhaitent préserver leur droit d’agir en justice. Le contentieux automatique appartient au passé : place à l’anticipation, à la méthode et au réflexe du dialogue structuré pour bâtir ses chances devant le tribunal.